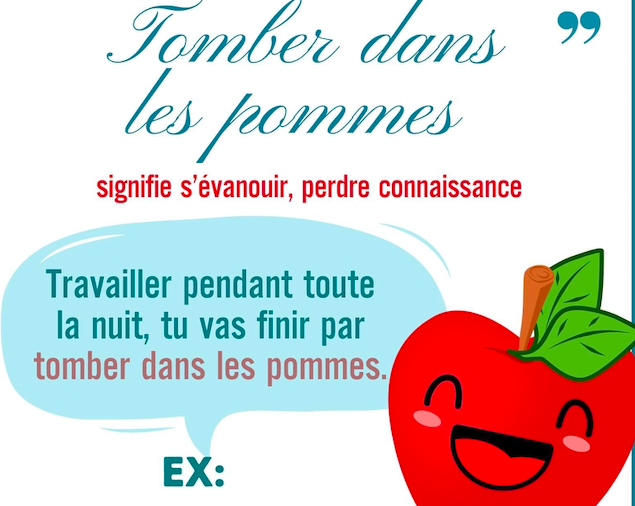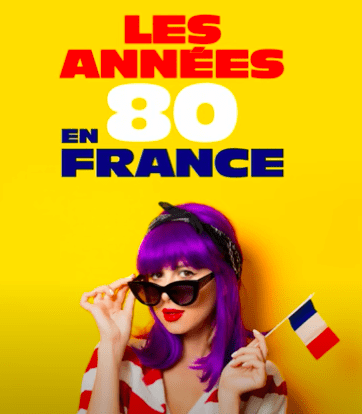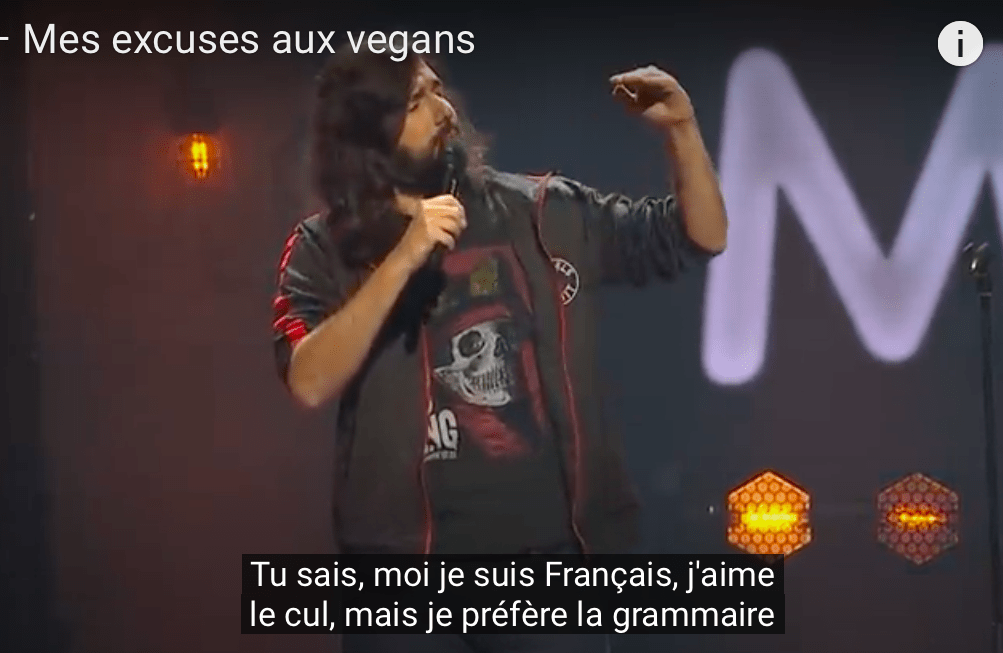« Je suis malade… » ; oui mais de quoi?
De la maladie d’amour à la maladie tout court, petite plongée dans un univers linguistique fort utile au quotidien. La chanson est une vecteur d’apprentissage important des langues car il fait appel à la musicalité de la langue et à une prosodie spécifique. Vous avez dû remarquer que certains de nos apprenants ont une meilleure […]
« Je suis malade… » ; oui mais de quoi? Lire la suite »